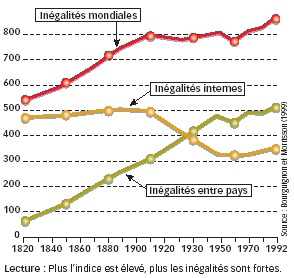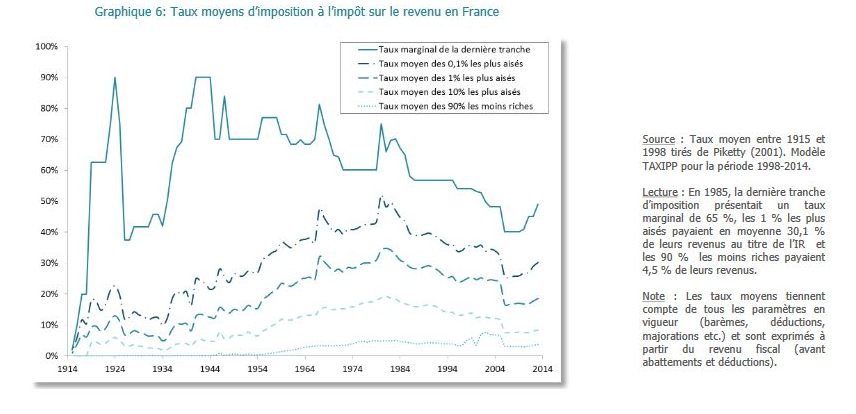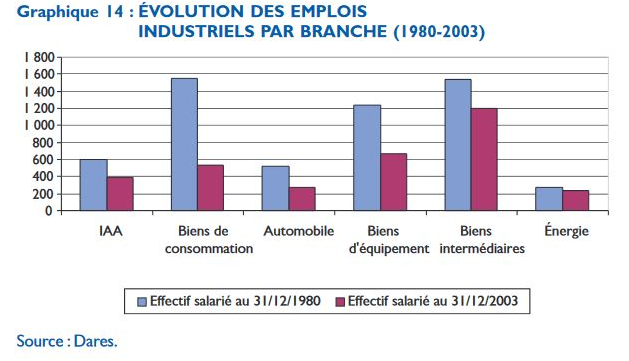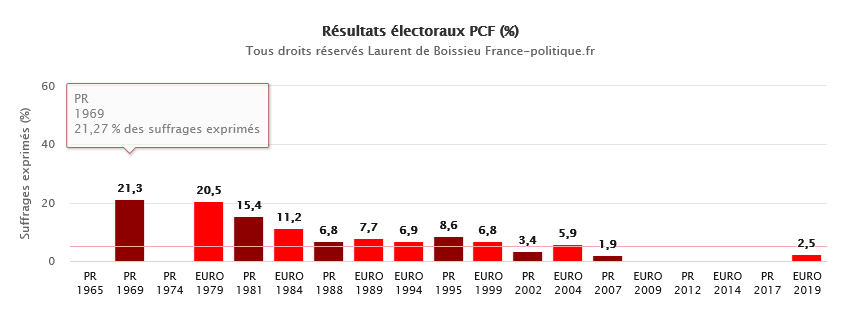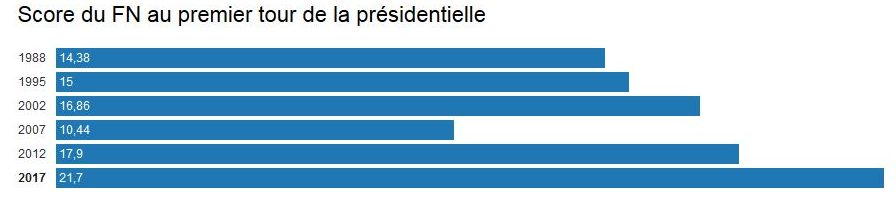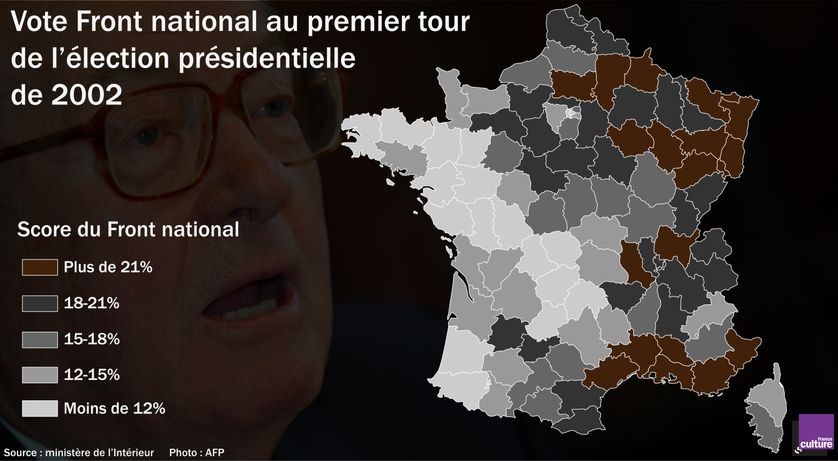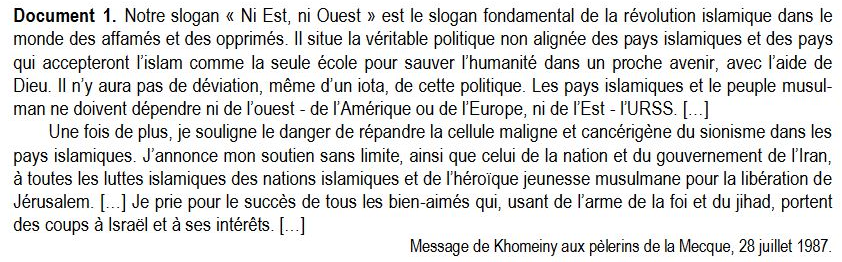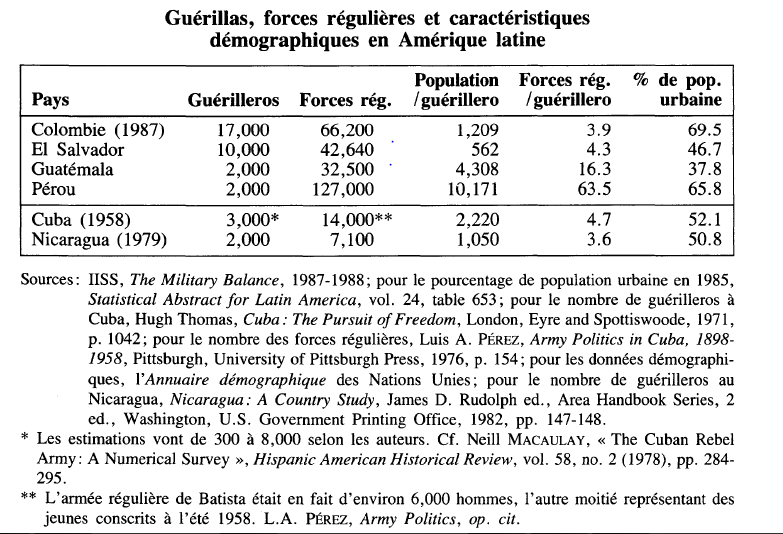La crise de 1973 ouvre une longue période d’alternance de
ralentissements et de croissances sur fond de taux de croissance du PIB
bas : 2.7 sur la période en moyenne pour les pays de l’OCDE. Mais les
situations sont différentes selon les pays. Pour les pays développés, à
partir de 1980, les politiques de dérégulation, de déréglementation, de
désétatisation et de délocalisation bouleversent les sociétés.
|
Croissance du PIB par habitant entre 1973 et 2001 pour quelques pays ou groupes de pays
|
|
Chine
|
4,27
|
|
Inde
|
2,29
|
|
Japon
|
1,81
|
|
Europe de l'Ouest et du Nord
|
1,69
|
|
Etats-Unis
|
1,67
|
|
France
|
1,61
|
|
Amérique latine
|
1,29
|
|
Afrique
|
1,06
|
| Source : Angus Maddison – 2003 |
Retour de fortes inégalités
Oubliée pendant les Trente glorieuses, la pauvreté refait surface
dans les rues des pays développés. A New York en 1993, chaque nuit, 23
000 personnes dorment dans la rue. En 1989, au RU on compte
officiellement 400 000 Sans Domicile Fixe. Là où l’Etat-providence se
maintient, la pauvreté est moins visible – mais les inégalités mondiales
progressent.
obr03_05_01.png
Inequality among World Citizens: 1820-1992. François Bourguignon; Christian Morrisson The American Economic Review, Vol. 92, No. 4. (Sep., 2002), pp. 727-744
Trois mesures des inégalités dans le monde, selon l’indice de Thei.
L’indice de Theil
L’indice de Theil est un indice de mesure d'inégalité fondé sur l'entropie de Shannon.
- Un indice de 0 indique une égalité absolue.
- Un indice de 0,5 indique une inégalité représentée par une société
où 74 % des individus ont 26 % des ressources et 26 % des individus ont
74 % des ressources.
- Un indice de 1 indique une inégalité représentée par une société où
82,4 % des individus ont 17,6 % des ressources et 17,6 % des individus
ont 82,4 % des ressources. (Wikipedia)
Quelques exemples de cette montée des inégalités : Aux Etats-Unis, en
Nouvelle-Zélande, en Australie, en Suisse, 20% des plus riches disposent
de 8 à 10 fois plus que les 20% des plus pauvres et 10% des plus riches
capturent 25% du revenu globale du pays. Au Brésil, 20% de la
population partagent 2.5% du revenu national et 10% les deux-tiers !
Citation
En ce qui concerne les pays riches, citons simplement un rapport
de 2001 de la Banque mondiale, une institution peu suspecte de noircir
le tableau : « Il y a eu une sérieuse progression des inégalités dans
ces pays [depuis 1980], inversant la tendance antérieure des années 1950
à 1980. » Cette tendance concerne 18 des 24 pays les plus développés.
Article de Jean Gadrey, économiste, extrait du magazine Alternatives Economiques n° 256 (03/2007)
Quelques exemples de cette montée des inégalités : Aux Etats-Unis, en
Nouvelle-Zélande, en Australie, en Suisse, 20% des plus riches disposent
de 8 à 10 fois plus que les 20% des plus pauvres et 10% des plus riches
capturent 25% du revenu globale du pays. Au Brésil, 20% de la
population partagent 2.5% du revenu national et 10% les deux-tiers !
La politique de l’offre est particulièrement illustrée par les taux
d’imposition français. Aux Etats-Unis le taux maximal baisse de 80% à
moins de 30% actuellement.
La désindexation des salaires sur les prix entraine des baisses de
pouvoir d’achat tandis que les politiques budgétaires diminuent les
prestations sociales :
Citation
« Le montant unitaire des prestations en métropole évolue
normalement en fonction d'une base mensuelle de calcul. Celle-ci était
revalorisée en fonction de l'inflation constatée de mars à mars. Mais
depuis 1984, la correction s'effectue en fonction de la hausse des prix
prévisionnelle avec, en principe, une remise à niveau si nécessaire au
1er janvier de l'exercice suivant. En 1989, la base a été revalorisée de
1,11 % au 1er janvier et de 1,01 % au 1er juillet
(. Compte tenu de ce mode de revalorisation, en moyenne annuelle,
elle a progressé de 2,5 % en 1989 alors que l'inflation a été de 3,6 %.
La régression en francs constants s'accentue : - 0,7 % en moyenne
annuelle depuis 1986 contre - 0,3 % sur la période 1978-1989. »
Ces inégalités vont avoir des conséquences politiques importantes dans tous les pays.
Délocalisations et globalisation
L’une des conséquences les plus spectaculaires de la politique de
baisse des coûts de production est le mouvement de délocalisation des
industries de main-d’œuvre. Le textile, la sidérurgie puis les
constructions mécaniques, tous les secteurs industriels phares de la
période précédente partent vers les pays du tiers-monde et en
particulier l’Asie. Au milieu des années 1980, la Chine, la Corée du
sud, l’Inde, le Mexique, le Venezuela, le Brésil et l’Argentine
produisent 15% de l’acier mondial et en consomment 24%. La vaste zone
industrielle des grands lacs américains perd ses usines et devient la Rust Belt. Dans
le même temps, la sidérurgie Lorraine en France employait 88 000
salariés en 1962 : elle est tombée à 8700 en 1999 et a pratiquement
disparu aujourd’hui.
Dans tous les pays industrialisés, la part des ouvriers dans la
population active diminue. Certaines industries ont pratiquement disparu
comme l’industrie textile où les emplois baissent de 43% entre 1974 et
1980 en France. De 398 116 emplois en 1968, l’industrie textile
française passe à 60 351 emplois en 2017 !
Car les emplois les plus facilement délocalisables sont les emplois
les moins qualifiés : les industries de biens de consommation sont
particulièrement touchées.
Une étude sur les mutations de l’industrie française 10 ans après le
déclenchement de la crise par un géographe français résume les
politiques menées :
Citation
Du côté de la main-d’œuvre on cherche à réduire les coûts et établir
des relations plus souples quitte remettre en cause la sécurité de
l’emploi. La délocalisation des activités voraces de travail peu
qualifié vers les pays ateliers du Tiers-Monde constitue un des
principaux volets de cette politique. Ainsi les Laboratoires Labaz
fabriquent du matériel médical élémentaire à Malte et au Portugal, la
Lainière de Roubaix a déplacé en Tunisie la production des tricots
Kodier, Thomson fait monter ses téléviseurs noir et blanc Singapour où
il possède aussi une usine assemblage des thermostats. Le recul du
salariat en France et son remplacement par des formules plus souples de
travail : la montée du tâcheronnage celle de la sous-traitance et
l’extension des emplois statut précaire travail temporaire et contrats
de travail durée limitée préfigurent peut-être les rapports sociaux de
production de demain.
Di Méo Guy. La crise du système industriel, en France, au début des
années 1980. In: Annales de Géographie, t. 93, n°517,1984. pp.
326-349;doi : https://doi.org/10.3406/geo.1984.20268
La fin du paragraphe est prémonitoire : mobilité, délocalisation,
sous-traitance, précarité sont les caractéristiques des emplois du XXIe
siècle.
a crise débouche sur des conséquences politiques graves
La crise de 1973 ouvre une ère politique nouvelle. La concomitance de
la crise à l’Ouest et à l’Est bouleverse les relations internationales
et la géopolitique mondiale. La disparition du bloc soviétique et les
changements économiques laissent un monde déboussolé, aussi bien en
Europe que dans le Tiers Monde.
La fin du modèle soviétique
A partir du milieu des années 60 et surtout dans les années 70, le
modèle soviétique entre en crise. Le type de développement extensif,
l’économie dirigée, l’absence de réformes politiques pénalisent
l’économie des pays de l’Est et de l’URSS. L’exposition aux autres
économies mondiales fait résonner la crise de 1973 dans les pays du bloc
soviétique. Quand l’URSS, déficitaire en grains et produits
alimentaires, se tourne vers les marchés mondiaux, elle subit les
mouvements des prix. De même, l’URSS exporte de plus en plus de gaz et
de pétrole, s’exposant aux aléas des cours. Le taux de croissance du PNB
passe de 6% à 2% dans les années 70 à 80. Le taux de productivité reste
très faible et le taux de croissance de la population diminue
engendrant des pénuries de main-d’œuvre dans un système encore extensif (Pipes Richard. L'URSS en crise. In: Politique étrangère, n°4 - 1982 - 47ᵉannée. pp. 867-880;doi : https://doi.org/10.3406/polit.1982.3262). Ces données des années 70-80 vont encore se détériorer avec la guerre
en Afghanistan, véritable gouffre financier et humain et la reprise de
la course aux armements par R. Reagan.
L’épuisement du modèle entraine une désaffection vis-à-vis du modèle communiste incarné par l’URSS :
- Dans les « démocraties populaires » où les révoltes grondent (Tchécoslovaquie 1968, Pologne à partir de 1980),
- Dans les pays occidentaux : baisse de l’influence des PC, crise de
la social-démocratie et essor de nouveaux partis (écologiste, extrême
gauche…),
- Dans les pays du Tiers Monde qui l’avaient adopté ou s’en étaient inspiré (Inde, Egypte…).
La disparition de l’URSS et la fin des « démocraties populaires », à
partir de 1989, jettent des millions d’habitants dans une
restructuration économique sans précédent. Les niveaux de vie
s’écroulent, les industries disparaissent, les investissements étrangers
achètent des secteurs entiers, changeant les modes de production.
Citation
En 2000, entre le quart et la moitié des investissements
industriels provenaient de capitaux étrangers. Les entreprises
occidentales, principalement dans le secteur automobile et des
transports, ont délocalisé leur production dans les pays d'Europe
centrale et orientale pour profiter de leur longue tradition
industrielle. Et ces pays sont rapidement entrés en concurrence pour
attirer ces capitaux et certains ont fait le choix de la
spécialisation….
…Les réformes furent souvent radicales : privatisation des
entreprises, dérèglementation des prix, reconversion des domaines
sinistrés comme l’industrie lourde, décollectivisation de la production
agricole. Cette « thérapie de choc » fut encadrée par le FMI ou par
l’Union européenne, via la BERD ou la BEI et les programmes « Phare »
L’Union européenne face au défi de la crise des pays d’Europe
centrale et orientale Auteur : Franck Lirzin, ancien élève de l’Ecole
Polytechnique et de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS), est ingénieur des mines. Fondation R.Schuman 20 avril 2009
Les PECO deviennent le champ libre des théories libérales.
obr03_05_07.png
L’Union européenne face au défi de la crise des pays d’Europe centrale et orientale Auteur : Franck Lirzin, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), est ingénieur des mines. Fondation R.Schuman 20 avril 2009
Après une phase difficile au cours des années 90, la croissance
redémarre et le PIB progresse. Mais les inégalités sont devenues très
fortes et le désarroi est profond. Des sociétés très soudées découvrent
les errements des sociétés libérales de l’Ouest : chômage, précarité,
insécurité …
obr03_05_08.png
La situation mondiale et l’agriculture et de l’alimentation, chapitre V Europe centrale et orientale, Rome 2001 FAO
Ces conditions de vie dégradées entraînent un exode de population
vers l’Ouest, une baisse de la natalité, des comportements politiques
erratiques, surtout sensibles dans les années 2000.
Crise du modèle démocratique européen.
La crise des années soixante-dix va profondément percuter les vies
politiques des pays de l’Ouest de l’Europe avant de toucher ceux de
l’Est. La France va ouvrir l’ère de la renaissance des nationalismes et
des forces politiques radicales.
En 1982, le gouvernement socialiste du Président F. Mitterrand change
de politique. De la relance Keynésienne, il s’aligne sur les politiques
néo-libérales. La déception est forte et ouvre une période de crises
politique. Le gouvernement d’Union de la gauche disparait, le PC, allié
des socialistes reprend son indépendance mais trop tard. Ce puissant
parti communiste voit ses résultats électoraux baisser inexorablement.
obr03_05_09.png
Sources : conseil constitutionnel, site France Politique | france-politique.fr le site d'information sur la vie politique française
La fin des PC en France n’est pas une exception : partout en Europe,
la chute des partis communistes s’accélère durant les années 80, jusqu’à
disparaitre parfois avec la fin du monde communiste. Cette évolution
laisse sans représentation politique des classes sociales comme les
ouvriers ou les employés particulièrement touchées par les évolutions
économiques.
La social-démocratie européenne a largement profité de la fin du
nazisme et de la guerre froide. Elle apparait, dans les années fastes
des trente glorieuses, comme une alternative à la dictature stalinienne
et au conservatisme des droites européennes. Elle s’appuie sur :
- Un fort consensus démocratique dans les institutions libérales
- Un Etat redistributeur, impartial et équitable
- Des services publics de qualité qui satisfont la classe moyenne et les classes populaires
- Un fort mouvement syndical et des négociations sociales
Mais la crise change tout :
- Retour des inégalités de revenus dans les années 90
- Baisse des dépenses sociales qui éloignent les classes moyennes
supérieures des services publics et pénalisent les classe populaires. La
société se coupe en deux : les plus riches cultivent l’entre soi.
- La disparition de la masse des ouvriers, souvent menacés de déclin
et de ne trouver que des emplois jusqu’ici réservés aux femmes ou aux
immigrés.
- Essor d’une immigration vécue comme une concurrence dans le contexte de crise.
Les partis socio-démocrates voient leur influence diminuer, ils
perdent 20% de leur électorat de 1970 à 2000. Les travaillistes anglais
perdent la suprématie (de 48% en 1966 à 27% en 1983) et sont menacés par
les libéraux-démocrates ou l’UKIP. Les travaillistes Israéliens,
proches des Européens et copiant le modèle, voient le nationalisme
l’emporter : ils passent de 46% en 1969 à 20% en 1999. Les partis
socio-démocrates de Scandinavie ne sont pas épargnés : moins 6,5% en
1989 en Norvège. En Suède le parti social-démocrate obtient 45% des
suffrages en 1982 et 26% en 1999.
En revanche, un autre courant politique entame une phase de forte
croissance et va profiter de ce vide politique : le nationalisme radical
à connotation raciste. C’est en France qu’il remporte ses premiers
succès sous le nom de Front National, regroupement de forces politiques
d’extrême-droite sous l’égide de J.M Le Pen. En 1983, le tournant de la
politique gouvernementale du gouvernement de gauche se paie cash : à
Dreux, lors d’une élection cantonale, le candidat local du FN obtient
10% des voix. Un an plus tard, il passe la barre des 15% sur un
programme sans ambiguïté : "Halte à l’immigration, du travail pour tous les Français ». Il
devient adjoint au maire de la droite conservatrice locale. En 1986, 36
députés du FN sont élus aux élections législatives. Depuis le FN est
devenu l’un des plus grand parti politique en France.
Significativement ce sont les régions industrielles touchées par les
délocalisations et les fermetures d’usines qui sont les plus favorables
au vote pour le FN. Ce vote cherche à protester contre les politiques
subies mais aussi contre la construction européenne qui s’accélère :
1986, acte unique, 1992 traité de Maastricht.
Ailleurs en Europe, des mouvements similaires naissent :
En Italie, la Ligue du Nord créée en 1989 cherche à s’émanciper du
cadre national pour créer un nouvel Etat : la Padanie. Elle adhère au
groupe de l’Europe des Nation avec les autres forces anti Européennes.
La Ligue sera au gouvernement de Berlusconi de 2001 à 2006.
En Autriche le vieux parti FPO créé en 1955 (réceptacle de
nostalgiques du nazisme), est repris en mains par Jorge Haider ne 1986
et devient ouvertement nationaliste, anti-immigrés en anti-européen. En
1999, il obtient 27% des voix et parvient au gouvernement.
En Belgique, le Vlams Block est fondé en 1978 sur le modèle du Front National :
Citation
En 1992 (quelques mois après une démarche similaire de Bruno
Mégret), son dirigeant Filip Dewinter proposait soixante-dix solutions
au « problème» de l’immigration, visant principalement les
non-européens, majoritairement musulmans : rétablissement du droit du
sang ; rapatriement forcé des étrangers en situation irrégulière,
chômeurs ou ayant subi une condamnation ; instauration d’une taxe à
l’emploi de salariés non européens ; limitation du droit des immigrés à
la protection sociale et création d’un système de sécurité sociale
distinct ; restriction des droits de propriété des étrangers…
LE VLAAMS BLOK ET LE « FLAMAND NATUREL » Bambi Ceuppens Presses de
Sciences Po « Critique internationale » 2001/1 no 10, pages 143 à
160ISSN 1290-7839ISBN 2724629124
Le Vlams Block passe de 2% à 15% des suffrages dans la partie Flamande de 1978 à 2001.
Ces quelques exemples montrent que la vie politique Européenne se
trouve durablement sous la menace de partis nationalistes radicaux qui
naissent à la faveur de la crise de 1973 et qui vont se renforcer
jusqu’à aujourd’hui.
La fin de la séduction des modèles occidentaux
La fin de la deuxième guerre mondiale, la forte croissance des deux
modèles concurrents, ont généré un immense espoir dans les pays du
tiers-monde :
- Ils sont indépendants (plus tard en Afrique avec la difficile décolonisation française)
- Ils sont en forte croissance démographique
- L’économie mondiale semble aller vers un rattrapage des pays développés
- Ils jouent un rôle sur la scène internationale : conférence de Bandoeng, d’Alger, création de la CNUCED…
Las, les rapports Nord/Sud restent ceux de la dépendance et les
années 70-90 sont marquées par les crises de la dette. En 1990, sept
pays sur 96 à économies faibles ou moyenne avaient une dette inférieure
au milliard de dollars. Les autres dépassent souvent les 10 milliards.
Dans ce contexte, la confiance envers les grands pays est rompue. Les
désillusions nourrissent des réactions extrêmes.
Les pays musulmans
En 1979, une grande crise débute : c’est un nouveau siècle pour les
musulmans, la révolution Iranienne met en place un régime religieux qui
paraît être un modèle à suivre. Un fondamentalisme musulman opposé aux
deux grands modèles (soviétique et américain, qui ont échoué dans le
développement de la région..) se développe.
La Révolution iranienne ouvre, comme un symbole, le nouveau siècle des musulmans.
Dans ce discours Ayatollah Khomeiny fustige les deux blocs et appelle
à rompre avec les modèles sociétaux des pays développés. Ce discours
aura un profond retentissement, d’autant que les occidentaux ont
largement soutenu l’Irak dans sa guerre de 10 ans contre l’Iran et
qu’ils soutiennent Israël contre les revendications des palestiniens.
L’intervention américaine de 1991en Irak achève de discréditer les
Etats-Unis, la chute de l’URSS a laissé les nationalistes arabes sans
soutiens internationaux. La radicalisation des populations se manifeste
dans le soutien aux guerres en Afghanistan, dans les intifada depuis
1986 puis dans le terrorisme d’Al Qaida à partir de 1987. Le profond
retentissement des attentats du World Trade Center va galvaniser les
plus radicaux. Le proche et Moyen Orient s’enfonce dans les guerres
religieuses (Liban, Syrie, Irak …).
Guerillas latino-américaines.
En Amérique Latine, les fortes inégalités et les problèmes
économiques entraînent une radicalisation politique déjà sous-jacente
dans les années 60. Le modèle Cubain, grâce au prestige de son combat
contre l’impérialisme américain génère des stratégies de prise de
pouvoir violente. L’absence de démocratie, la force du régime militaire
largement soutenu par les Etats-Unis engendre des années de violences.
Le coup d’envoi est donné par le coup d’Etat contre le président
Allende au Chili en 1973. Le pays sera ensuite dirigé d’une main de fer
par le gouvernement militaire du Général Pinochet qui reçoit les
économistes de l’école libérale : les Chicago boys.
obr03_05_13.png
Études internationales, Guérilla et terrorisme en Amérique latine, Yvon Grenier, Volume 19, numéro 4, 1988
Ces guérillas « traditionnelles », essentiellement rurales, se
doublent de guérillas urbaines en Argentine notamment, engendrant des
répressions féroces. Avant le coup d’Etat de 1976 en Argentine, ce pays
sert de base de repli pour le cône sud. Les Tupamaros uruguayens, le MIR
chilien (« Mouvement de gauche révolutionnaire »), l’ELN bolivienne («
Armée de libération nationale ») et l’ERP argentine (« Armée
révolutionnaire du peuple »), tentent de se coordonner.
obr03_05_14.png
Site, L’histoire, 2 janvier 2019, les régimes autoritaires en Amérique Latine, Carte
En représailles, les régimes militaires se coordonnent à leur tour
dans le plan Condor visant à travailler en commun contre les
oppositions.
Il faudra attendre la fin des années 90 pour voir des élections libres et démocratiques en Amérique Latine (La démocratie en Amérique latine, Graciela Ducatenzeiler et Victoria Itzcovitz. Dans Revue internationale de politique comparée 2011/1 (Vol. 18), pages 123 à 140).